[Est Républicain]
Les livres en Lorraine - Page 35
-
Charles Alexandre de Lorraine, dernier duc de Lorraine
-
Charles-Alexandre de Lorraine, un prince en sa maison
 Voilà le résultat d'un rendez-vous manqué. Cet ouvrage aurait dû être le support d'une exceptionnelle exposition présentée au château de Lunéville consacrée à Charles-Alexandre de Lorraine à l'occasion du tricentenaire de sa naissance. Mais les circonstances en ont décidé autrement...
Voilà le résultat d'un rendez-vous manqué. Cet ouvrage aurait dû être le support d'une exceptionnelle exposition présentée au château de Lunéville consacrée à Charles-Alexandre de Lorraine à l'occasion du tricentenaire de sa naissance. Mais les circonstances en ont décidé autrement...Quoi qu'il en soit l'association des Amis de Lunéville, créée au lendemain du sinistre qui ravagea le château de Léopold en 2003, associée au Centre d'études et de recherches sur les collections de la Maison de Lorraine et du roi de Pologne, oeuvre depuis cette date à la redécouverte d'un exceptionnel patrimoine mobilier et artistique dispersé en 1737, au moment du départ de François III, puis en 1766 à la mort de Stanislas Leszczynski.
Fruits des recherches entreprises, notamment par Jacques Charles-Gaffiot, ce catalogue apporte une foule d'informations inédites ainsi qu'une iconographie renouvelée sur le sujet, ayant une ampleur sans commune mesure avec les pièces présentées lors de l'exposition de l'été 2012. L'amateur d'art et le passionné de l'histoire de la Maison de Lorraine y découvriront quantité de meubles, tableaux, médailles, dessins et autres objets qui ont marqué le quotidien du prince Charles-Alexandre dans ses résidences successives, à Lunéville et à Bruxelles.
Beau-frère de l'impératrice Marie-Thérèse de Habsbourg et oncle de Marie-Antoinette, Charles-Alexandre de Lorraine, né à Lunéville le 12 décembre 1712, figure parmi les plus grands princes collectionneurs de son temps. Nommé gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, il s'établit à Bruxelles qu'il hausse au rang de capitale des Arts autour du palais qu'il fait reconstruire. Passionné depuis son plus jeune âge par les sciences et les techniques, il aime aussi à dresser croquis et dessins des machines qu'il invente afin d'améliorer la vie quotidienne de ses sujets.
Son ancienne résidence lunévilloise, la Favorite, élevée sur les plans de l'architecte Germain Boffrand au bout du parc du palais construit par Léopold, son père, est de nos jours laissée à l'abandon. Cet ouvrage souhaite aussi attirer l'attention du public et des décideurs sur ce monument qui risque de disparaître à tout jamais.
‡ Charles-Alexandre de Lorraine, un prince en sa maison, Jacques Charles-Gaffiot (dir.), Association des Amis de Lunéville - Les Editions du Net, 2012, 380 p., ill. (38 €).
-
"Notes de campagne 1914-1916" par Jean Duclos, sous-lieutenant au 153e RI
 Les notes de campagne de Jean Duclos furent rédigées en 1917 pendant les loisirs auxquels le contraignait sa situation de grand blessé interné en Suisse, après sept mois de captivité en Allemagne où il fut, selon ce qu'il en rapporte, correctement soigné. Elles décrivent en détail et dans un style impeccable, l'expérience d'un jeune homme de "bonne famille" qu'a priori, sauf un vibrant amour de la Patrie, rien ne prédisposait à se jeter corps et âme dans une guerre épouvantable.
Les notes de campagne de Jean Duclos furent rédigées en 1917 pendant les loisirs auxquels le contraignait sa situation de grand blessé interné en Suisse, après sept mois de captivité en Allemagne où il fut, selon ce qu'il en rapporte, correctement soigné. Elles décrivent en détail et dans un style impeccable, l'expérience d'un jeune homme de "bonne famille" qu'a priori, sauf un vibrant amour de la Patrie, rien ne prédisposait à se jeter corps et âme dans une guerre épouvantable.Loin de renvoyer le lecteur à un système de valeurs périmé, le texte de Jean Duclos est l'illustration de qualités d'autant plus recommandables que la société post-moderne d'aujourd'hui tend à leur faire écran. Que ce soit en Lorraine lors de la bataille de Morhange ou au Grand-Couronné, ou en Picardie (1914) où il fut une première fois blessé, en Artois ou en Champagne où il fut à nouveau blessé (1915) ou encore durant les épreuves de la captivité (1916) qui s'ensuivit, ce passionnant récit est celui d'un tout jeune officier de troupe engagé avec un parfait oubli de soi et un esprit de sacrifice absolu dans l'exercice d'un devoir qu'il estimait sans limite au sein d'une fraternité d'armes pudique et chaleureuse.
Jean Duclos est né en 1891 à Rouen. Affecté en avril 1914 comme sous-lieutenant au 153e régiment d'infanterie au cours de son service militaire, il prit part aux batailles de cette unité en 1914 et 1915. Resté dans l'armée d'active après l'Armistice, il fut tué au Maroc en 1925.
‡ Jean Duclos, sous-lieutenant au 153e RI. Notes de campagne 1914-1916, Louis-Jean Duclos (présenté par), éditions L'Harmattan, 2012, 225 p., ill. (23 €).
-
D'Einsiedeln à la Salette au fil des siècles
 Petite incursion chez nos voisins Francs-Comtois et leur riche histoire religieuse...
Petite incursion chez nos voisins Francs-Comtois et leur riche histoire religieuse..."Il est peu de provinces où le culte de la Mère de Dieu ait été aussi répandu, aussi florissant que dans la Franche-Comté" écrivait le chanoine Jean-Marie Suchet en 1892. Cette affection pour la Vierge Marie s'est exprimée par les manières variées dont nos pères lui dirent leur fois au cours des siècles.
Avec l'Alsace, la Lorraine méridionale et la Savoie, le Comté de Bourgogne et ses habitants ont été attirés depuis longtemps par la Vierge Noire d'Einsiedeln, en Suisse, et par d'autres sanctuaires petits ou grands, proches ou lointains. Hommes et femmes y allaient à pied implorer la Mère de Jésus.
Les auteurs consacrent un livre de mémoire à une ardeur religieuse et une piété populaire que les années 1950-1960 ont été les dernières à connaître. Cette synthèse entend montrer avec de nombreux exemples à la clé comment les anciens Francs-Comtois - mais aussi les Vosgiens - ont vécu et exprimé leur amour et leur dévotion pour la Vierge Marie et, par sa médiation, à Dieu lui-même.
Les auteurs, Odile et Richard Moreau, dans la filiation de Henri Pourrat et de l'abbé Jean Garneret sont passionnés par la vie des Francs-Comtois d'autrefois, leur foi chrétienne et leur dévotion.
‡ D'Einsiedeln à la Salette au fil des siècles avec les pèlerins comtois sur les pas de la Vierge Marie, Odile et Richard Moreau, éditions L'harmattan, 2012, 296 p., ill. (30 €).
-
Metz, ville de nature
 Nos villes ne sont pas que des lieux bruyants et pollués où règnent le béton et l'asphalte. En raison de son passé chargé d'histoire, de sa diversité architecturale, de sa situation et des aménagements, Metz possède bien des atouts qui la prédisposaient à un mariage fructueux avec la biodiversité.
Nos villes ne sont pas que des lieux bruyants et pollués où règnent le béton et l'asphalte. En raison de son passé chargé d'histoire, de sa diversité architecturale, de sa situation et des aménagements, Metz possède bien des atouts qui la prédisposaient à un mariage fructueux avec la biodiversité.Des bords de la Moselle à ceux de la Seille, du jardin botanique à celui des tanneurs, des anciens forts de Queuleu et Bellecroix au parc du Pas-du-Loup, la nature est bien présente à Metz. Cet ouvrage, éclairé par de nombreuses et agréables photographies, invite le lecteur et l'amateur de nature et d'environnement à découvrir certaines des espèces animales et végétales qui ont élu domicile dans les principaux habitats qui composent cette ville verte.
Ouvrez l'oeil et partez à la rencontre de la nature dans la ville !
‡ Metz ville de nature, Association régionale de défense de l'environnement par l'image, éditions Serpenoise, 2012, 205 p., ill. (30 €).
-
L'aventure du chemin de fer à Etain et son canton
L’Association Etain d’Hier à Aujourd’hui publier un ouvrage consacré à l’aventure du Chemin de Fer à Etain et dans son canton.
Agrémenté de plus de 400 illustrations, le livre présente l’évolution des lignes de chemin de fer au cours de ces 140 années d’existence : création des voies, des gares, leur développement puis leur disparition, la vie des cheminots, le matériel. Y sont traitées les gares de Verdun et son dépôt de machines à vapeur, celle d’Etain avec son projet de triage, celle d’Eix-Abaucourt avec son nœud ferroviaire, celle de Buzy avec ses voies de service, ainsi que le tacot de la Woëvre qui desservait les petites gares de Châtillon-sous-les-Côtes, Moulainville et Eix-Abaucourt.
Les voies ferrées militaires dont les Allemands avaient couvert la région pendant la Grande Guerre ainsi que les lignes américaines ne sont pas oubliées.
‡ L'aventure du chemin de fer : Etain et son canton, Association Etain d'Hier à Aujourd'hui, 2012, 144 p., ill. (22 €).
‡ L'ouvrage peut être commandé (accompagné d’un chèque de 27 €, port inclus, libellé à l’ordre de "EHA") à : Association ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI, 18 Place Rouillon, 55400 ETAIN.
-
Aloyse Stauder, un Lorrain dans la tourmente 1914-1918
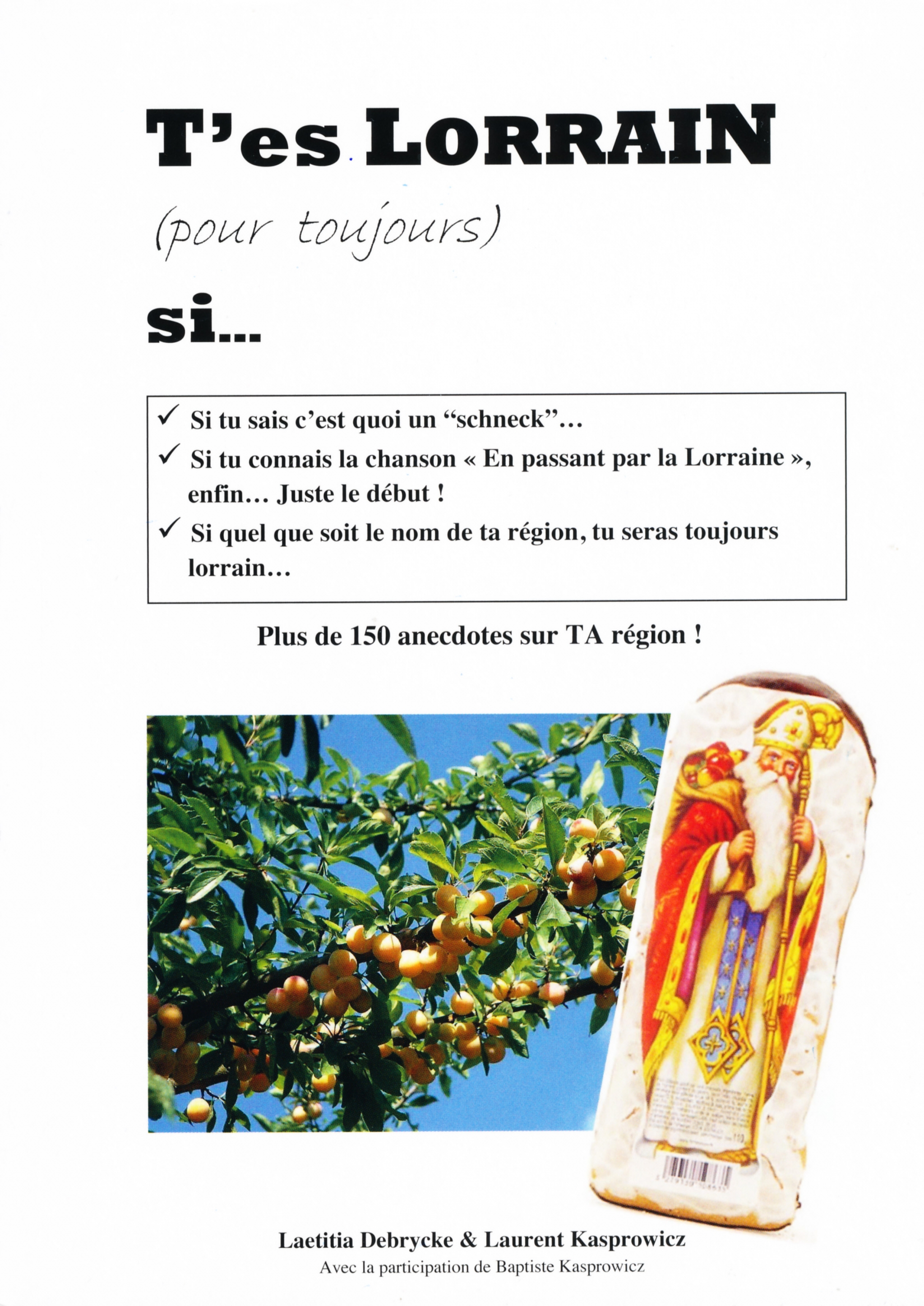 Aloyse Stauder est mosellan né en 1891. Il commence son noviciat chez les jésuites et est encore étudiant lorsqu'il est incorporé dans l'armée allemande en 1917. Il est envoyé sur les fronts russe et français.
Aloyse Stauder est mosellan né en 1891. Il commence son noviciat chez les jésuites et est encore étudiant lorsqu'il est incorporé dans l'armée allemande en 1917. Il est envoyé sur les fronts russe et français.L'ouvrage met en lumière le destin d'un homme qui incarne l'état d'esprit d'une partie de la Lorraine annexée, mais aussi l'histoire d'une génération, la première des Malgré-Nous. Les carnets d'Aloyse Stauder, présentés par Pauline Guidemann et préfacés par Jean-Noël Grandhomme, constituent une source inédite importante pour la compréhension du phénomène des Malgré-Nous qui se manifeste dès la Première Guerre mondiale en Alsace-Lorraine. Cette expression, inventée en 1920, désigne les soldats incorporés sous l'uniforme allemand alors qu'ils étaient de souche française et - pour beaucoup - de coeur français.
En effet, en 1914, du fait du traité de Francfort de 1871 et de l'annexion de l'Alsace-Moselle par le Reich, ces descendants d'"anciens français" sont contraints de se battre contre leurs anciens compatriotes. Ils sont ainsi plus de 380 000 à subir cette situation.
Tout au long de son récit, Aloyse Stauder proclame sa francophilie en opposant sa foi catholique et son amour de la France au protestantisme prussien. Il finit par déserter en 1918 et s'engage dans la Marine française avant d'être démobilisé en 1919.
‡ Aloyse Stauder. Un Lorrain dans la tourmente 1914-1918, Pauline Guidemann (présenté par), éditions du Belvédère, 2012, 287 p. (18 €).
-
Les grands événements de la Haute-Marne
 Petite visite chez nos voisins champenois pour vous présentez un ouvrage original qui passe en revue tous les événements majeurs qui ont marqué l'histoire de Haute-Marne, entre Langres et Saint-Dizier, au cours du XXe siècle.
Petite visite chez nos voisins champenois pour vous présentez un ouvrage original qui passe en revue tous les événements majeurs qui ont marqué l'histoire de Haute-Marne, entre Langres et Saint-Dizier, au cours du XXe siècle.Dans ces pages se côtoient personnalités, figures locales et acteurs connus de la vie du département : le général De Gaulle, bien sûr, Marcel Arland, Maurice Constantin-Weyer, Camille Flammarion, André Theuriet, mais aussi Edgar Pisani, Roger Michelot, José Meiffret, etc. Qu'ils soient inventeurs, hommes politiques, scientifiques, sportifs, peintres, militaires ou simples anonymes, tous, un jour, se sont retrouvés et révélés sous les projecteurs de l'actualité. Ils ont écrit, à leur manière, les pages de cette histoire de la Haute-Marne à la faveur d'un événement ancré à jamais dans les mémoires, comme l'assassinat de la petite Nicole Marescot à Chaumont, l'arrivée de la plasturgie à Langres, la création du Vert-Bois à Saint-Dizier, la capture du Zeppelin L49 entre Serqueux et Bourbonne-les-Bains, le face-à-face De Gaulle-Adenauer à Colombey-les-Deux-Eglises ou encore la performance du Chaumontais Edouard Persin, lanterne rouge du Tour de France 1928... Autant d'épisode que l'auteur retrace en pertinent chroniqueur.
L'auteur, Bruno Théveny, est journaliste, éditorialiste et écrivain. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres sur l'histoire contemporaine en Haute-Marne et dans les Vosges.
‡ Les grands événements de la Haute-Marne 1900-2000, Bruno Théveny, éditions De Borée, 2012, 424 p., ill. (26 €).
-
Sidérurgie lorraine, nos plus belles années
 L'ouvrage est un hommage par l'image et par le texte à tous ces hommes et ces femmes qui, grâce à leur savoir-faire et leur endurance, ont construit la sidérurgie lorraine, connu son apogée au cours des "Trente Glorieuses" et contribué à cette incroyable épopée industrielle. Il est aussi l'album de plusieurs générations, une mémoire vivante, pour des milliers de familles qui, des décennies durant ont vue les grands-parents, les parents, les enfants entrer à l'usine sans se poser de questions, juste après le centre d'apprentissage. C'était le "bon vieux temps", celui du "Texas lorrain", de la splendeur de l'acier.
L'ouvrage est un hommage par l'image et par le texte à tous ces hommes et ces femmes qui, grâce à leur savoir-faire et leur endurance, ont construit la sidérurgie lorraine, connu son apogée au cours des "Trente Glorieuses" et contribué à cette incroyable épopée industrielle. Il est aussi l'album de plusieurs générations, une mémoire vivante, pour des milliers de familles qui, des décennies durant ont vue les grands-parents, les parents, les enfants entrer à l'usine sans se poser de questions, juste après le centre d'apprentissage. C'était le "bon vieux temps", celui du "Texas lorrain", de la splendeur de l'acier.Ce livre nous raconte l'Histoire, celle des années bonheur où la sidérurgie lorraine tournait à plein régime et "boostait" l'économie régionale. A travers des centaines de photographies - toutes en noir et blanc -, dont la plupart sont inédites, le lecteur retrouvera la vie comme elle était vécue à l'époque. Le feu, les fumées, le haut fourneau, l'aciérie, l'agglomération, les bureaux... Mais aussi les cités, les écoles ménagères, les hôpitaux, les terrains de sports, les fêtes de Noël, les colonies de vacances... L'ambiance, les couleurs, les personnages, tout y est. Tous les sites lorrains aussi : Neuves-Maisons, Longwy, Villerupt, Pompey, Pont-à-Mousson, Hayange, Florange, Thionville, Gandrange, Joeuf et bien d'autres encore.
Un beau livre-mémoire où l'on découvrira des paroles de sidérurgistes et des textes d'universitaires.
‡ Sidérurgie lorraine. Nos plus belles années, collectif, éditions Serpenoise, 2012, 151 p., ill. (30 €).
-
La folle vie du révolutionnaire Jean-Baptiste Drouet
Que sait-on de Jean-Baptiste Drouet ? On évoque son rôle, certes primordial, lors de l'arrestation du roi Louis XVI à Varennes-en-Argonne, aux confins de la Lorraine et de la Champagne. Mais la vie romanesque qui s'en suivit semble être oubliée par l'Histoire. Et pourtant, que d'événements mémorables ont émaillé son existence !
Député de la Marne, tribun redouté, totalement engagé dans l'idéal qu'il s'est forgé, on le suivra à la tribune de l'Assemblée, en prison en Moravie, en fuite aux Canaries. Puis, on verra le bouillant révolutionnaire endosser le costume de sous-préfet de Sainte-Ménéhould et finir sa vie en proscrit.
Cette biographie n'est pas écrite pour les historiens ou les érudits. Elle s'adresse à un public le plus large possible, sans l'assommer par de nombreux détails, des dates et des noms dont il n'a cure.
L'auteur a replacé les événements dans leur environnement pour dépasser l'énumération des faits qui perdent leur épaisseur et leur sens s'ils ne sont pas insérés dans leur contexte social et local. Il s'est bien gardé de porter jugement sur les choix de Drouet. L'Histoire a besoin de chercheurs qui servent la connaissance, et de vulgarisateurs qui la font connaître au grand public. François Duboisy souhaite se ranger parmi ces derniers.
-
"L'Echo des 3 Provinces" de l'hiver est paru
 Le magazine des habitants du Pays des Trois Provinces - Champagne, Franche-Comté et Lorraine - paraît fidèlement tous les deux mois grâce au travail acharné d'une poignée d'amoureux de ce territoire écartelé entre trois régions administratives mais uni par une histoire et des paysages.
Le magazine des habitants du Pays des Trois Provinces - Champagne, Franche-Comté et Lorraine - paraît fidèlement tous les deux mois grâce au travail acharné d'une poignée d'amoureux de ce territoire écartelé entre trois régions administratives mais uni par une histoire et des paysages.Le sommaire de ce numéro hivernal est riche de la variété des villages et des bourgs qui constellent ce pays : retour sur le projet de Parc naturel régional du Pays des Trois Provinces, découverte de l'ancienne huilerie de Bleurville, poèmes et poésies, rénovation du porche du cimetière de Damblain, la campagne de fouilles archéologiques à Morimond, les 7 ans de la borne des 3 Provinces à Enfonvelle, à la découverte de Combeaufontaine, voyage à Blâmont et Bataville, un ferronnier d'art à Senaide, les compte rendus des visites de l'été, les animations...
‡ L'Echo des 3 Provinces peut être commandé auprès de evelyne.relion@orange.fr
-
Le Chasseur de La Mothe
 Le Chasseur de La Mothe, roman historique d'Alcide Marot, est enfin réédité ! Le Lorrain Alcide Marot publia cette chronique en 1892 s'inscrivant dans le courant du fort sentiment identitaire lorrain qui alimenta une riche vie intellectuelle entre la deuxième moitié du XIXe siècle et le premier quart du XXe. Une belle relation d'amitié le liait à Georges Sadoul, le rédacteur en chef du Pays Lorrain, et à l'écrivain Maurice Barrès.
Le Chasseur de La Mothe, roman historique d'Alcide Marot, est enfin réédité ! Le Lorrain Alcide Marot publia cette chronique en 1892 s'inscrivant dans le courant du fort sentiment identitaire lorrain qui alimenta une riche vie intellectuelle entre la deuxième moitié du XIXe siècle et le premier quart du XXe. Une belle relation d'amitié le liait à Georges Sadoul, le rédacteur en chef du Pays Lorrain, et à l'écrivain Maurice Barrès.Le Chasseur de La Mothe nous replonge dans un épisode historique qui n'est rien d'autre que les longues prémices du rattachement de la Lorraine à la France.
L'action du livre se situe au milieu du XVIIe siècle, aux moments du dernier siège de la vieille cité du Bassigny lorrain, superbe ville fortifiée qui abritait en 1645 plus de 4000 habitants. Notre héros, Sébastien de Maillefert est capitaine et major d'infanterie à La Mothe et sert le duc Charles IV. Il est habile arquebusier et traverse avec hardiesse les lignes françaises durant le dernier siège qui se solda, sur ordre de Mazarin, par la destruction totale de La Mothe. Il est chasseur comme on ne l'imagine plus aujourd'hui et c'est au travers de ses sorties que l'on comprend mieux l'atmosphère d'une époque et les derniers instants d'une communauté de vie aux confins de la Lorraine, de la Champagne et de la Comté de Bourgogne.
Les faits historiques décrits sont avérés et parfaitement mis en scène par Alcide Marot. Les vertus du Chasseur de La Mothe sont à la lisière du réel et de l'imaginaire. L'écriture en est délicieuse.
Aujourd'hui, et plus que jamais, il est utile de se réapproprier dans une ardente volonté, les contes de toujours, les lire et les dire à nouveau. Nos territoires regorgent de récits où les acteurs d'aventure n'étaient point semblables aux hommes de notre temps ; le destin leur accordait d'autres pouvoirs que les nôtres et les maintenait hors des limites de la naissance et de la mort.
La réédition du Chasseur de La Mothe restaure la mémoire d'un territoire - aujourd'hui bien oublié - et le talent d'un écrivain, Alcide Marot.
L'auteur, Alcide Marot, est né à Sauville (Vosges) en 1862. Il reçut sa formation intellectuelle auprès du curé de Nijon (Haute-Marne) qui fut complétée au petit séminaire de Langres. Il fut maire de Nijon à la suite de son père. Alcide Marot est décédé en 1927. Il publia notamment Essai d'histoire des villages du canton de Bourmont (1925) et Dix poésies en patois du Bassigny lorrain et une servante d'autrefois.
‡ Le Chasseur de La Mothe. Chronique lorraine, Alcide Marot, éditions Imagine-Networks, 2012, 124 p. (18,50 €).
-
La Nouvelle revue lorraine n° 17 : entre nature et histoire
 Jean-Marie Cuny nous propose ce mois-ci le 17ème numéro de sa Nouvelle revue lorraine. Il nous fait découvrir notamment un homonyme, Jacques Cuny, un Vosgien qui fait découvrir les Vosges aux Vosgiens... et à tous ceux qui aiment cette nature à taille humaine imprégnée de traditions.
Jean-Marie Cuny nous propose ce mois-ci le 17ème numéro de sa Nouvelle revue lorraine. Il nous fait découvrir notamment un homonyme, Jacques Cuny, un Vosgien qui fait découvrir les Vosges aux Vosgiens... et à tous ceux qui aiment cette nature à taille humaine imprégnée de traditions.Le sommaire est encore riche de nombreux récits qui vous feront découvrir la Lorraine d'hier et d'aujourd'hui :
- Plombières la Jolie
- La Petite-Fosse
- Jeanne d'Arc et Poissy
- Deux oeuvres de Monchablon à Domremy
- La mort du dernier loup de Tranqueville
- Mes "loups" du Bois-le-Prêtre
- Henri Poincaré, un génie aux racines lorraines
- Henri Cordebard, pharmacien et chimiste
- Jeûne et abstinence au XVIIe siècle sous le duc Charles III
- Renaissance mise à mal à Metz
- Cigognes au pays de Sarrebourg
- Le charbonnier
- Les formulettes enfantines
- Alain Cotinaut-Kempf, artiste peintre
Et les rubriques habituelles : la revue vous avise, les livres, d'une revue à l'autre...
‡ En vente en librairie ou à commander (7 € le numéro ou abonnement : 38 € pour 6 numéros) en s'adressant à : La Nouvelle revue lorraine, Le Tremblois, 54280 LANEUVELOTTE.
-
Daum, l'âme des verriers
 En 2009, le livre Daum, du verre et des hommes paraissait et faisait l'unanimité de la critique, tant des spécialistes et amateurs d'art que des anciens verriers, maîtres et ouvriers. Aujourd'hui cet ouvrage a pratiquement disparu des librairies.
En 2009, le livre Daum, du verre et des hommes paraissait et faisait l'unanimité de la critique, tant des spécialistes et amateurs d'art que des anciens verriers, maîtres et ouvriers. Aujourd'hui cet ouvrage a pratiquement disparu des librairies.Une nouvelle édition, enrichie et différentes, s'est imposée car, au fil de rencontres parfois fortuites, d'autres documents et témoignages ont été collectés ; il eut été dommage d'en priver les passionnés.
De 1875 à 1986, l'auteur balaie les cinq générations qui ont créé, développé et dirigé l'entreprise. Il suit le parcours des maîtres verriers, artistes et collaborateurs ayant oeuvré dans les différents ateliers. Il invite le lecteur à une promenade poétique à travers l'Art Nouveau, l'Art Déco, l'Art des formes libres et la pâte de verre. Il fait également découvrir cette ville de Nancy qui accueillit de nombreux exilés alsaciens-lorrains arrachés à leur terroir au lendemain de la guerre de 1870.
Cette seconde version, plus proche du souhait initial de l'auteur, apporte d'autres éclairages. Elle s'attarde notamment sur la période allant de 1945 à 1986, la plus récente, à la fois passionnante et bouleversante.
Passionnante car elle connut de nombreuses innovations et se distingua par la collaboration d'artistes atypiques et renommés comme Dali et César, mais aussi de jeunes talents comme l'arrière-petit-fils d'Antonin Daum dans les années 1980. Bouleversante car elle sonna la fin des verriers traditionnels, ceux de la halle qui maniaient si élégamment la canne en perpétuant un savoir-faire millénaire.
Daum, l'âme des verriers recèle des textes plus riches et une iconographie grandement inédite. Puissiez-vous encore rêver et aimer un peu plus ces hommes qui ont tout donné pour que les pièces qu'ils ont façonnées émerveillent et suscitent l'émotion, celle que les mots ne parviennent pas à traduire tant elle vous époustoufle.
‡ Daum, l'âme des verriers, Patrick-Charles Renaud, éditions Vent d'Est, 2012, 368 p., ill. (24 €).
-
"La Barrette" de décembre de Saint-Pierre-des-Latins de Nancy
La communauté latine de l'église Saint-Pierre de Nancy vous propose son bulletin paroissial de décembre :
-
La bataille de Dompaire des 11-14 septembre 1944
Gilbert Salvini, président du Cercle d'études locales de Contrexéville, nous communique une synthèse des évènements qui se sont déroulés entre le 11 et le 14 septembre 1944 dans la plaine des Vosges. Cette épisode important de la libération du territoire national est entré dans l'Histoire sous la nom de "Bataille de Dompaire".
‡ Plus de précisions in Le pays de Dompaire, actes des Journées d'études vosgiennes 2011, Fédération des Sociétés savantes des Vosges, 2012. Communication de Gilbert Salvini sur la bataille de Dompaire, p. 541-554.
-
"Le bâtisseur de rêves", un roman historique de Roger Poinsot
Se glissant dans la peau de Marius, notre auteur, Roger Poinsot, part de Pompéï pour suivre César dans la guerre des Gaules et arrive à la côte du Hautmont, proche de Marey, petit village de l'ouest du département des Vosges actuel.
C'est la rencontre entre deux cultures qui deviendront la nôtre, la gallo-romaine. C'est aussi la passion pour deux femmes...
Le premier roman de Roger Poinsot « Les Racines du Bien » est toujours en vente.
Hyacinthe part de La Mothe, belle cité lorraine fortifiée disparue pour vivre dans le village de Marey. On est en 1645, l'obscurantisme et la faim font des ravages... Ce grand père qui survit est peut-être le vôtre...
Roger Poinsot édite à compte d'auteur.
Illustrations réalisées par Roger Poinsot pour son ouvrage "Le bâtisseur de rêves".
Commande à adresser à : Roger POINSOT, 14 rue de la Joie, 88320 MAREY
Couriel : roger.poinsot@wanadoo.fr - Tél. : 03 29 09 75 79
M., Mme, Mlle .................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
code postal : ......................
Commune : ......................................................................................................
commande ....... ouvrage(s) "Les racines du bien" à 18 €
commande ....... ouvrage(s) "Le bâtisseur de rêves" à 20 €
Je désire recevoir ma commande à l'adresse ci-dessus (+ 4 € de port)
Ci-joint mon règlement de la somme de ............ €
signature :
-
"Daum, l'âme des verriers" : animations autour de la sortie du livre le 8 décembre
-
Contes vosgiens
 Au mi-temps de l'automne, c'est le moment tout indiqué pour se plonger dans une lecture de contes. Une lecture au coin du feu. Belle occasion aussi de (re)découvrir les contes de deux auteurs lorrains, Emile Erckmann et Alexandre Chatrian, qui ont bercé les jeunes années de nos grands-parents. Et n'allez pas me dire que ces écrits ont vieilli ! Non point. Comme la plupart des contes et nouvelles d'Erckmann-Chatrian - à la façon de Maupassant -, les Contes vosgiens s'inscrivent dans le décor de la Lorraine du XIXe siècle et plus précisément des Vosges du Nord, ces Vosges bâties sur le grès rouge et peuplées de forêts sombres...
Au mi-temps de l'automne, c'est le moment tout indiqué pour se plonger dans une lecture de contes. Une lecture au coin du feu. Belle occasion aussi de (re)découvrir les contes de deux auteurs lorrains, Emile Erckmann et Alexandre Chatrian, qui ont bercé les jeunes années de nos grands-parents. Et n'allez pas me dire que ces écrits ont vieilli ! Non point. Comme la plupart des contes et nouvelles d'Erckmann-Chatrian - à la façon de Maupassant -, les Contes vosgiens s'inscrivent dans le décor de la Lorraine du XIXe siècle et plus précisément des Vosges du Nord, ces Vosges bâties sur le grès rouge et peuplées de forêts sombres...Erckmann-Chatrian nous offrent des histoires authentiques, bien ancrées dans la réalité folklorique de ces Vosges ballotées entre Lorraine et Alsace. On y découvre des histoires faites d'un réalisme rustique influencé par les conteurs germaniques et se transfigurant en une sorte d'épopée populaire.
Nos auteurs ont exploité les paysages et tous les registre du folklore, encore bien vivant en ce XIXe siècle, de cette Lorraine gréseuse et sylvestre.
‡ Contes vosgiens, Emile Erckmann et Alexandre Chatrian, CPE éditions, 2012, 141 p. (18,90 €).
-
Françoise de Graffigny rentre à Lunéville
 Le château de Lunéville accueille jusqu'au 16 décembre 2012 une splendide collection qui rassemble 135 éditions différentes des Lettres d'une Péruvienne, roman écrit par la Lorraine Françoise d'Happoncourt plus connue sous le nom de Françoise de Graffigny.
Le château de Lunéville accueille jusqu'au 16 décembre 2012 une splendide collection qui rassemble 135 éditions différentes des Lettres d'une Péruvienne, roman écrit par la Lorraine Françoise d'Happoncourt plus connue sous le nom de Françoise de Graffigny.Ces éditions ont été patiemment collectées par Pierre Mouriau de Meulenacker qui en a fait don au château de Lunéville. Cet immense travail est désormais offert à l'admiration du grand public.
Le catalogue édité à cette occasion rassemble plusieurs contributions de spécialistes de l'oeuvre de Madame de Graffigny. Au mi-temps des années 1750, notre Lorraine née à Nancy en 1695, sera la femme écrivain la plus célèbre du monde. Elle doit cette renommée soudaine à deux oeuvres principalement : un roman, Lettres d'une Péruvienne, en 1747, et une pièce de théâtre, Cénie, représentée à la Comédie-Française en juin 1750 où elle remporte un triomphe instantané. Cependant, après un demi-siècle de gloire, l'oeuvre de Françoise de Graffigny, est tombée dans l'oubli. Mais à la fin du XXe siècle, on a redécouvert le romain et exhumé sa correspondance inédite, ce qui lui fait maintenant un troisième titre de gloire !
L'ouvrage nous révèle une dramaturge féconde dont l'oeuvre a bénéficié d'une multitude d'éditions aux XVIIIe et XIXe siècles. Les nombreux exemplaires des différentes éditions des Lettres d'une Péruvienne recueillis par Pierre Mouriau de Meulenacker laisse entrevoir la variété et la richesse des reliures ainsi que des ex-libris, donnant des indications précieuses sur les propriétaires et les lecteurs de l'oeuvre de Madame de Graffigny.
‡ Françoise de Graffigny rentre à Lunéville, Pierre Mouriau de Meulenacker (dir.), Conseil général de Meurthe-et-Moselle - Musée du Château de Lunéville, 2012, 86 p., ill. (15 €).
-
Quatre siècles de fortifications en Lorraine
 Malgré un nombre de destructions considérables, la Lorraine conserve sur son sol des ouvrages fortifiés de toutes les époques qui permettent de suivre l'évolution de l'architecture militaire depuis les temps les plus reculés. Cette étude propose un panorama illustré de tout ce qui a été réalisé depuis l'aménagement des premiers bastions, au début des années 1540, jusqu'à la construction de notre dernier système fortifié dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale.
Malgré un nombre de destructions considérables, la Lorraine conserve sur son sol des ouvrages fortifiés de toutes les époques qui permettent de suivre l'évolution de l'architecture militaire depuis les temps les plus reculés. Cette étude propose un panorama illustré de tout ce qui a été réalisé depuis l'aménagement des premiers bastions, au début des années 1540, jusqu'à la construction de notre dernier système fortifié dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale.Sont donc évoquées les places fortes antérieures à la guerre de Trente Ans, les activités de Vauban et de ses successeurs, les forts construits à la veille de la Première Guerre mondiale et les ouvrages allemands de la Lorraine annexée, le rôle joué par les fortifications en 1914-1918 et enfin la ligne Maginot.
Stéphane Gaber, membre de l'Académie de Stanislas, est passionné par les problématiques que pose l'existence des frontières, qu'il s'agisse de leur évolution au cours de l'histoire ou des questions suscitées par leur défense. Après avoir rédigé, entre 1991 et 2005, plusieurs livres et articles sur l'architecture militaire en Lorraine, il publie ce nouvel ouvrage de synthèse dans lequel il développe comment la Lorraine est passée du bastion inventé au XVIe siècle aux ouvrages bétonnés et cuirassés de la ligne Maginot.
‡ Quatre siècles de fortifications en Lorraine. Des premiers bastions à la ligne Maginot, Stéphane Gaber, éditions Serpenoise, 2012, 170 p., ill. (35 €).
-
Petites histoires de la grande Lorraine [50 avant J.-C. - 2013]
 Ce livre à la plaisante lecture détaille en vingt-sept épisodes, étalés depuis la Gaule romaine au bord de la Moselle jusqu'au Sillon entre nos villes, le feuilleton souriant de l'histoire de la Lorraine. Il ne manque personne, de Charlemagne aux distributeurs de tracts d'Arcelor Mittal, aucun fait, de la République de Metz aux étudiants d'Artem à Nancy, aucun lieu des Vosges du textile à la Meuse fromagère.
Ce livre à la plaisante lecture détaille en vingt-sept épisodes, étalés depuis la Gaule romaine au bord de la Moselle jusqu'au Sillon entre nos villes, le feuilleton souriant de l'histoire de la Lorraine. Il ne manque personne, de Charlemagne aux distributeurs de tracts d'Arcelor Mittal, aucun fait, de la République de Metz aux étudiants d'Artem à Nancy, aucun lieu des Vosges du textile à la Meuse fromagère.Michel Caffier, avec une plume appliquée et avec une bonne dose d'humour, mêle aux grands personnages de la Lorraine, fidèles à eux-mêmes, des hommes et des femmes de son cru imaginatif. On se sent tous Lorrains.
L'auteur, Michel Caffier, est originaire de Boulogne-sur-Mer. Journaliste, grand reporter et critique littéraire, il est aussi l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages, essais, romans et albums sur la Lorraine.
‡ Petites histoires de la grande Lorraine [50 avant J.-C. - 2013], Michel Caffier, éditions Serpenoise, 2012, 142 p. (15 €).
-
Au diable la tiédeur !
 En France, comme dans de nombreux pays d'Europe occidentale, l'Eglise catholique chante-t-elle son chant du cygne ? Si des paroisses sont encore vivantes, si des chrétiens sont à l'oeuvre, annonçant la beauté de la foi et du message évangélique, il faut bien reconnaître que bon nombre de nos contemporains, pourtant baptisés dans le Christ, estiment qu'ils n'ont plus besoin de l'Eglise pour vivre le mystère de Dieu. La crise est profonde.
En France, comme dans de nombreux pays d'Europe occidentale, l'Eglise catholique chante-t-elle son chant du cygne ? Si des paroisses sont encore vivantes, si des chrétiens sont à l'oeuvre, annonçant la beauté de la foi et du message évangélique, il faut bien reconnaître que bon nombre de nos contemporains, pourtant baptisés dans le Christ, estiment qu'ils n'ont plus besoin de l'Eglise pour vivre le mystère de Dieu. La crise est profonde.A Marseille, en pleine quartier cosmopolite, l'abbé Michel-Marie Zanotti-Sorkine a ressuscité une paroisse moribonde, faute de fidèles. La renaissance est spectaculaire : la foule se presse lors des messes dominicales, les conversions et les retours à la foi sont nombreux. Le dimanche, le peuple de Dieu s'y rassemble, attiré par la qualité et la dignité de la liturgie, et la prédication et la sacralité qui imprègne ce lieu sacré. Cent soixante-deux baptêmes d'adultes ont été célébrés à Pâques. L'église des Réformés est ouverte 12 heures par jour, la messe est dite quotidiennement au maître-autel, le culte est célébré dans le rite traditionnel avec processions solennelles, enfants de choeur nombreux, encens, grandes orgues, chants, chapelets dits en commun, confessions quotidiennes...
Cette "réussite" pourrait-elle en inspirer d'autres ?
Ce livre, hymne à l'ardeur, s'adresse à ceux qui éprouvent le besoin de repenser leur action à la lumière d'une expérience sacerdotale présentée ici sous forme d'aphorismes percutants : cinquante pages de pensées, conseils, sentences simples et fortes à destination des prêtres. Cette partie est suivie d'une seconde destinée aux fidèles et aux autres pour leur rappeler les bases du catholicisme ainsi que des comportements et des vertus qui aident à vivre.
Un petit bouquin d'une richesse inouïe qui donne envie de croire en Dieu... et à l'Eglise !
L'auteur, l'abbé Michel-Marie Zanotti-Sorkine est né en 1959. Il a d'abord été chanteur-compositeur-interprète dans des cabarets parisiens. A 28 ans, il étudie la philosophie et la théologie puis entre chez les Franciscains. En les quittant, il vient à Marseille où il est ordonné prêtre à 40 ans ; l'évêque lui confie la paroisse des Réformés, en haut de la Canebière. Il est l'auteur de six livres.
On peut suivre l'actualité de l'abbé Zanotti-Sorkine et celle de sa paroisse marseillaise sur son site Internet delamoureneclats.fr
‡ Au diable la tiédeur suivi d'un Petit traité de l'essentiel, Michel-Marie Zanotti-Sorkine (abbé), Robert Laffont éditeur, 2012, 191 p. (14,90 €).
-
Annales de l'Est n° 1-2012 : "histoire urbaine, histoire politique"
 La première livraison des Annales de l'Est pour 2012 viennent de paraître. Cette revue de l'association d'historiens de l'Est propose un dossier intitulé "Histoire urbaine, histoire politique" avec les contributions suivantes : les villes vosgiennes pendant la Révolution, un bouleversement ou de fortes continuités ? par Jean-Paul Rothiot ; faire campagne dans les grandes villes de la France contemporaine de la fin du XIXe siècle à nos jours, par Jean El Gammal ; topographie parisienne de la peine capitale (1815-1870), par Laurence Guignard ; les traces de la présence industrielle dans l'urbanisme en Lorraine, par Pascal Raggi ; la vie musicale à Prague de la Première République tchécoslovaque à la fin du Protectorat de Bohême-Moravie, par Didier Francfort ; New York, évolution d'un centre de la vie musicale juive au XXe siècle, par Jean-Sébastien Noël.
La première livraison des Annales de l'Est pour 2012 viennent de paraître. Cette revue de l'association d'historiens de l'Est propose un dossier intitulé "Histoire urbaine, histoire politique" avec les contributions suivantes : les villes vosgiennes pendant la Révolution, un bouleversement ou de fortes continuités ? par Jean-Paul Rothiot ; faire campagne dans les grandes villes de la France contemporaine de la fin du XIXe siècle à nos jours, par Jean El Gammal ; topographie parisienne de la peine capitale (1815-1870), par Laurence Guignard ; les traces de la présence industrielle dans l'urbanisme en Lorraine, par Pascal Raggi ; la vie musicale à Prague de la Première République tchécoslovaque à la fin du Protectorat de Bohême-Moravie, par Didier Francfort ; New York, évolution d'un centre de la vie musicale juive au XXe siècle, par Jean-Sébastien Noël.Par ailleurs, le sommaire s'enrichit de "mélanges" avec les articles suivants :
- les hommes et le travail du fer dans le duché de Bar à la fin du Moyen Âge : le cas de forges de Moyeuvre vers 1450-1500, par Adrien Aitanti
- une dynastie de petits capitaines d'industrie : Althoffer & Cie (1811-2011), par Bertrand Risacher
- Anne-François de Beauvau (1617-1669) : la vocation missionnaire d'un gentilhomme lorrain, par Amélie Vantard
- une querelle entre ecclésiastiques devant la justice du Parlement de Metz (1747-1750), par Jean-Bernard Lang
- Marie-Edmée... Une artiste lorraine oubliée, par Nicole Cadène
- pour une histoire sociale et culturelle de la Fanfare : l'exemple de la région de Nancy de la Libération aux années Quatre-vingt, par Laurent Martinot
Et les rubriques habituelles : recensions d'ouvrages sur l'histoire de la Lorraine et présentation de soutenances de thèses à l'Université de Lorraine.
‡ Les Annales de l'Est n° 2 - 2012 sont disponibles sur abonnement (40 € pour l'année) ou à commander au numéro (23 € le numéro, chéque à libeller à "Association d'Historiens de l'Est") à : Association d'Historiens de l'Est, CRULH, Campus Lettres & Sciences humaines, 3 place Godefroy-de-Bouillon, 54000 NANCY
-
Le patrimoine du Grand Nancy
 "Le patrimoine constitue plus que jamais un enjeu fort du rayonnement d'un territoire. L'essor du tourisme, le développement économique, la qualité des paysages urbains, l'émergence de nouveaux quartiers ou de pôles universitaires d'excellence, mais aussi l'exigence partagée d'un urbanisme et d'une architecture qui soient respectueuses des lieux, puisent leur source dans une inscription patrimoniale garante des valeurs humaines, de culture, de tradition et de cohésion sociale." Ainsi s'exprime André Rossinot, maire de Nancy, dans son avant-propos.
"Le patrimoine constitue plus que jamais un enjeu fort du rayonnement d'un territoire. L'essor du tourisme, le développement économique, la qualité des paysages urbains, l'émergence de nouveaux quartiers ou de pôles universitaires d'excellence, mais aussi l'exigence partagée d'un urbanisme et d'une architecture qui soient respectueuses des lieux, puisent leur source dans une inscription patrimoniale garante des valeurs humaines, de culture, de tradition et de cohésion sociale." Ainsi s'exprime André Rossinot, maire de Nancy, dans son avant-propos.La notion de patrimoine, en effet, ne cesse de s'enrichir. L'héritage des villes ne se limite plus aujourd'hui à la somme des bâtiments que l'histoire additionne. Désormais, ce legs patrimonial apparaît comme le produit d'une "ambiance urbaine".
C'est ainsi qu'à Nancy le patrimoine des dépliants touristiques est loin de rendre compte de la richesse de l'agglomération. C'est cette richesse que nous fait découvrir l'auteur qui explore dans cet ouvrage mille ans d'histoire nancéienne, occasion pour le visiteur - mais aussi pour l'habitant et les Lorrains amenés à "transiter" par la capitale ducale - d'appréhender la variété de ce patrimoine singulier et de s'interroger sur son devenir.
Le livre bénéficie d'une exceptionnelle iconographie due au photographe Olivier Dancy.
‡ Le patrimoine du Grand Nancy, Pierre Gras, éditions du Patrimoine, 2012, 180 p., ill. (35 €).
-
Le visage de Jeanne d'Arc
 Jeanne d'Arc, où est ton visage ? Eternelle question, éternelle quête de tous les historiens, de tous les johannistes de tous les temps... Est-il dans enfoui dans les archives du Vatican qui rassemblent tout ce qui a trait à la vie de cette fille venue des marches de Lorraine ? Est-il représenté dans les milliers de bijoux, sculptures, gravures, statuettes équestres, en pied, ou petits objets personnels éclectiques qui ont exalté à l'époque de la béatification et de la canonisation toute cette génération du début du XXe siècle ?
Jeanne d'Arc, où est ton visage ? Eternelle question, éternelle quête de tous les historiens, de tous les johannistes de tous les temps... Est-il dans enfoui dans les archives du Vatican qui rassemblent tout ce qui a trait à la vie de cette fille venue des marches de Lorraine ? Est-il représenté dans les milliers de bijoux, sculptures, gravures, statuettes équestres, en pied, ou petits objets personnels éclectiques qui ont exalté à l'époque de la béatification et de la canonisation toute cette génération du début du XXe siècle ?Nul doute que la conformation du portrait de Jeanne est là, même si les traits du visage demeurent évidemment inperceptibles. A chacun de le découvrir, et de le faire s'épanouir en considérant, avant tout, qu'il doit s'intégrer dans le style et le contexte de cette première moitié du XVe siècle français. Au-delà, admirons la créativité et le talent de ces artistes qui ont rêvé de celle qui est devenue l'héroïne nationale et la sainte universelle, patronne de la France.
Claude Jacqueline publie dans cet étonnant catalogue sa collection personnelle de statuettes, de médailles et d'objets donnant à voir le visage de Jeanne d'Arc. On y découvrira également avec intérêt la série monétaire en circulation avant et pendant l'épopée Johannique. Avec des illustrations en couleurs !
Six cents ans après sa naissance, le visage de Jeanne reste toujours un mystère malgré ses innombrables représentations.
‡ Le visage de Jeanne d'Arc, Claude Jacqueline, éditions Errance, 2012, 111 p., ill. (39 €).
-
La céramique funéraire mérovingienne conservée au Musée Lorrain à Nancy
 La Lorraine a tenu une part non négligeable dans le développement de l'archéologie mérovingienne en France, avec les travaux des érudits du XIXe siècle, à qui l'on doit une part importante des collections conservées dans les musées de Lorraine. Parmi celles-ci, encore en grande partie inédite, l'importante série de vases du Musée Lorrain tient la première place au niveau régional, avec plus de 250 exemplaires. Elle fut enrichie en 1955 grâce aux legs de son ancien conservateur, Georges Goury, préhistorien mais aussi grand collectionneur, qui récolta des pièces issues principalement de nécropoles champenoises.
La Lorraine a tenu une part non négligeable dans le développement de l'archéologie mérovingienne en France, avec les travaux des érudits du XIXe siècle, à qui l'on doit une part importante des collections conservées dans les musées de Lorraine. Parmi celles-ci, encore en grande partie inédite, l'importante série de vases du Musée Lorrain tient la première place au niveau régional, avec plus de 250 exemplaires. Elle fut enrichie en 1955 grâce aux legs de son ancien conservateur, Georges Goury, préhistorien mais aussi grand collectionneur, qui récolta des pièces issues principalement de nécropoles champenoises.La collection du Musée Lorrain concerne presque exclusivement du matériel d'origine funéraire, attribuable, dans sa grande majorité, aux VIe et VIIe siècles de notre ère. Il traduit l'usage de déposer un ou plusieurs vases dans la sépulture, le plus souvent aux pieds du défunt, inhumé avec ses accessoires vestimentaires et son armement ou sa parure pour les femmes. Le vaisselier d'époque mérovingienne, moins diversifié qu'à l'époque gallo-romaine, hérite en partie des traditions antiques, peu à peu supplantées par des formes et des techniques importées lors des grandes migrations. Les vases sont le plus souvent à profil anguleux et sont parfois pourvus d'un décor poinçonné ou bien obtenu à l'aide d'une molette à motifs géométriques prédominants.
L'étude de cette production céramique , proposée par cet ouvrage, longtemps délaissée, est un instrument de connaissance non négligeable de la société mérovingienne à travers ses pratiques funéraires mais aussi les courants commerciaux et les échanges qui ont présidé une économie beaucoup moins fermée qu'il n'y paraît.
Les auteurs : Sébastien Brunella est professeur d'histoire-géographie, Jacques Guillaume est ingénieur d'études au CNRS et Rachel Prouteau est doctorante en archéologique à l'Inrap.
‡ La céramique funéraire mérovingienne conservées au Musée Lorrain à Nancy, Sébastien Brunella, Jacques Guillaume et Rachel Prouteau, PUN - éditions universitaires de Lorraine, 2012, 127 p., ill. (15 €).
-
Quand les Romains débarquaient en Lorraine méridionale... Un nouveau livre de Roger Poinsot
‡ Contact : roger.poinsot@wanadoo.fr
-
La Gestapo en Moselle
 Figure d'épouvante dans la mémoire collective, personnification de la terreur arbitraire pour le grand public, la Gestapo est pourtant l'un des acteurs de la répression les moins connus de la France des années d'occupation.
Figure d'épouvante dans la mémoire collective, personnification de la terreur arbitraire pour le grand public, la Gestapo est pourtant l'un des acteurs de la répression les moins connus de la France des années d'occupation.Acune publication ne s'est intéressée à son fonctionnement quotidien, à ses effectifs, au parcours de son personnel, à leurs motivations, à leurs méthodes. Cédric Neveu, jeune historien spécialiste de la répression et des polices du parti national-socialiste, propose la première étude jamais publiée en France. sur un service régional de la Gestapo, qui plus est, dans une région annexée au Reich entre 1940 et 1945 constituant un enjeu centrale pour l'Europe allemande voulue par Hitler. A partir d'archives allemandes, anglaises et françaises, pour la plupart totalement inédites, il retrace l'histoire de ce service, son organisation, l'itinéraire de ses cadres et leurs techniques de lutte au service de la nazification de la Lorraine. Il révèle également toute la complexité de cette police, sa place dans le dispositif répressif nazi, ses relations avec les autres acteurs allemands, les complicités dans la population locale.
Dressant le bilan de quatre années de répression, il évoque aussi l'après-guerre clémente que beaucoup de ces hommes connaissent dans une Allemagne en reconstruction.
‡ La Gestapo en Moselle. Une police au coeur de la répression nazie, Cédric Neveu, éditions Serpenoise, 2012, 303 p., ill. (24 €).
-
Abbayes des Vosges, quinze siècles d'histoire
 En 590, le moine irlandais Colomban a fondé le premier monastère des Vosges, à Luxeuil. Dans son sillage, et tout au long du Moyen Âge, le massif vosgien s'est couvert d'un "blanc manteau d'abbayes, de couvents et de monastères", constituant un véritable mont Athos d'Occident.
En 590, le moine irlandais Colomban a fondé le premier monastère des Vosges, à Luxeuil. Dans son sillage, et tout au long du Moyen Âge, le massif vosgien s'est couvert d'un "blanc manteau d'abbayes, de couvents et de monastères", constituant un véritable mont Athos d'Occident.A la fois centres spirituels et lieux du pouvoir seigneurial, les abbayes vosgiennes régnaient sur de vastes territoires, possédant des villages entiers et dirigeant la vie de milliers de personnes. Les moines et les moniales défrichaient et géraient la forêt, cultivaient les champs et les vignes, élevaient des troupeaux, exploitaient des mines et commerçaient avec toute l'Europe. Il y avait les bénédictins, les dominicains, les prémontrés et les cisterciens, de langue germanique ou romane, composant un réseau actif et complexe, en essor presque constant malgré les vicissitudes de l'histoire, jusqu'à l'arrêt brutal provoqué par la Révolution.
Lieux de prière immergés au coeur de la montagne, les abbayes des Vosges furent aussi des centres d'érudition et d'art rayonnants, produisant dans leurs scriptoria des manuscrits liturgiques de toute beauté, conservant dans leurs immenses bibliothèques les savoirs du monde entier et créant des trésors d'architecture, de sculpture et de peinture.
Après les destructions de la funeste Révolution et la dispersion des moines, nombre de bâtiments servirent au XIXe siècle de carrières de pierre ou furent utilisés par l'industrie textile naissante, comme à Munster ou Senones. Plus lentement, après un déclin généralisé, plusieurs centres spirituels réapparurent (Mont Saint-Odile, Lepuix-Gy, Trois-Epis). D'autres sites servent aujourd'hui de support culturel de renom, comme les dominicains de Guebwiller ou les trois abbayes de Senones, Moyenmoutier et Etival, en valorisant le patrimoine culturel et touristique d'un massif placé aux marges des trois régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté.
Grâce au remarquable travail de synthèse de Damien Parmentier, cet ouvrage rend aux trente-huit monastères du massif vosgien l'incomparable éclat qui les a fait briller pendant plus d'un millénaire.
‡ Abbayes des Vosges. Quinze siècles d'histoire, Damien Parmentier, La Nuée Bleue - Editions Serpenoise, 2012, 255 p., ill. (25 €).








